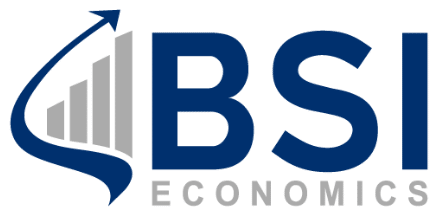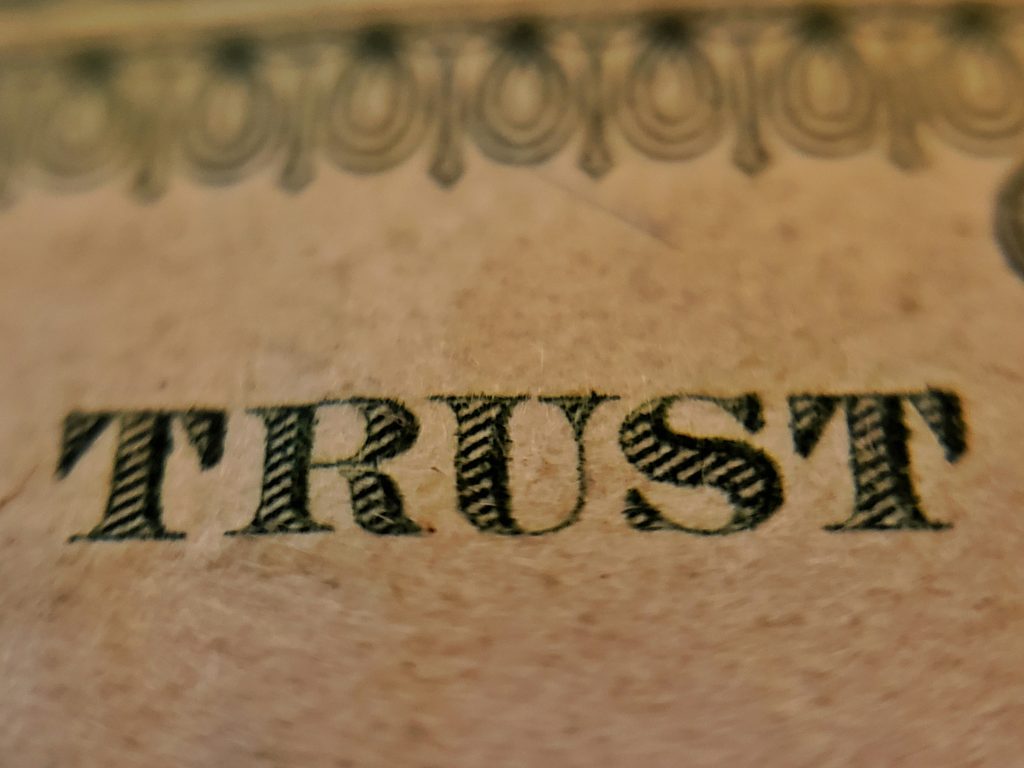La stabilité des prix est le pilier fondamental de la Banque nationale suisse (BNS). Mais dans le contexte suisse, elle ne peut être comprise indépendamment des spécificités structurelles du pays : inertie salariale, rôle du franc suisse comme actif refuge, ouverture commerciale élevée et forte crédibilité institutionnelle. Ces éléments façonnent un régime monétaire unique parmi les économies avancées.
La Suisse maintient depuis plus de deux décennies une inflation moyenne nettement inférieure à celle de ses homologues. Cette performance découle en partie d’une dynamique salariale modérée, en l’absence d’indexation automatique des salaires sur les prix. Selon les travaux de Kitov et Kitov (2011), l’élasticité de l’inflation aux variations du chômage y est proche de celle du Japon, soit dix fois plus faible que celle observée aux États-Unis. L’inertie nominale contribue à désactiver les mécanismes classiques de boucle prix-salaires. Elle permet aussi de neutraliser, partiellement, les chocs temporaires sur les prix de l’énergie ou des biens importés.
À cela s’ajoute un ancrage solide des anticipations. L’analyse de Fazio, Powell et Williams (2023) sur la crédibilité des banques centrales en petites économies ouvertes montre que la BNS est perçue comme l’une des institutions les plus fiables en matière de maîtrise de l’inflation, avec la Norvège et la Suède. L’ancrage des prévisions à moyen terme réduit l’amplitude des ajustements de taux réels et amortit la volatilité importée.
Mais la variable centrale de l’équation suisse reste le taux de change. Dans une économie où les importations représentent près de la moitié du PIB, la monnaie nationale devient le principal vecteur de transmission des décisions monétaires. Une appréciation du franc entraîne rapidement une désinflation importée. Fink, Frei, Maag et Zehnder (2023) ont montré qu’un relèvement de 25 points de base du taux directeur provoque une appréciation immédiate de +0,8 % du franc, soit un effet trois à quatre fois supérieur à celui observé dans la Zone euro. La répercussion sur l’inflation, bien que graduelle, est significative : une hausse de 1 % du taux de change nominal réduit l’inflation d’environ 0,15 point en quatre trimestres.
Face à cette sensibilité, la stratégie de la BNS repose sur une prévision d’inflation conditionnelle à trois ans, fondée sur l’hypothèse d’un taux directeur inchangé. Introduit en 2000, ce cadre rompt avec le ciblage d’inflation rigide de la Banque centrale européenne (BCE) et la moyenne symétrique de la Réserve fédérale (Fed). Comme l’a souligné Kohli (2010), cette approche conditionnelle protège contre les erreurs d’anticipation autoréalisatrices qui peuvent découler de guidances trop précises. Elle permet également une lecture probabiliste de l’inflation, intégrant les incertitudes liées à la conjoncture mondiale.
La communication institutionnelle a gagné en profondeur au fil du temps. Depuis 2015, la BNS a systématisé les graphiques de type « fan charts » et intégré la notion de « franc comme stabilisateur externe » dans ses discours publics. En 2025, elle a franchi un nouveau cap avec la publication, quatre semaines après chaque décision, d’un résumé structuré des délibérations de politique monétaire. Cette évolution rapproche la BNS des standards de transparence des grandes banques centrales tout en préservant la collégialité des débats.
Cependant, la complexité du contexte global rend la conduite de la politique monétaire plus incertaine. Depuis 2022, les tensions géopolitiques et la montée du protectionnisme ont engendré des divergences durables dans les trajectoires d’inflation entre grandes zones monétaires. Le rapport de l’OCDE (2024) sur la fragmentation monétaire note que la corrélation entre les taux d’inflation européens et américains est tombée de 0,9 à 0,6 en trois ans. Pour la Suisse, cette décorrélation accroît l’instabilité du franc. Lorsque la Fed abaisse ses taux, les flux vers le franc se renforcent, et la BNS doit arbitrer entre stabilité des prix et compétitivité.
Dans ce contexte, les modèles dynamiques globaux sont essentiels pour comprendre les interactions entre chocs externes et inflation domestique. Les travaux de la Banque des Règlements Internationaux (2024) sur les petites économies ouvertes montrent que la transmission des politiques monétaires étrangères est deux fois plus rapide en Suisse qu’en Zone euro, et que la sensibilité de l’inflation aux prix importés y est trois fois plus forte. L’ouverture financière, combinée à la crédibilité de la BNS, renforce cette exposition.
En définitive, la stabilité des prix en Suisse n’est pas le produit d’un automatisme monétaire. Elle est le résultat d’un équilibre exigeant entre ancrage institutionnel, adaptation stratégique et lecture fine du contexte global. Dans un monde où les chocs sont plus fréquents, plus fragmentés et moins corrélés, cette stabilité repose sur une gouvernance monétaire à la fois rigoureuse, souple et ouverte à la coordination analytique internationale. C’est cette capacité à conjuguer discipline nationale et lucidité mondiale qui assure à la Suisse sa résilience monétaire.

Télécharger le pdf : lequilibre-suisse-de-politique-monetaire-policy-brief